Entretien avec Lara Pawson
A la lecture du livre In the name of the people de la journaliste britannique Lara Pawson, on se lance dans un profond voyage à travers les événements de mai 1977, au moment où un différend interne au MPLA entraîna de nombreuses morts, affectant d’innombrables Angolais ainsi que les générations qui suivirent, de par les difficultés qu’il laissa derrière lui dans la gestion des différends et des critiques, mais aussi la banalisation de la répression. Lara Pawson se plongea dans une recherche forcenée, s’entretenant avec plusieurs sources, des survivants, des proches, des personnes concernées, des chercheurs, des témoins, des collaborateurs. Certains plus anonymes que d’autres, mais dont les vies furent irrémédiablement liées à ce moment.
En plus d’une écriture journalistique attrayante et exhaustive, qui nous permet d’accéder au monde dense de chaque personnage et de chaque portrait brossé, nous accompagnons, grâce au livre, le processus de recherche et de positionnement de l’auteur, avec ses hésitations, ses enthousiasmes, ses difficultés… pour finalement réussir à comprendre quelques-unes des causes et des conséquences du massacre. En abordant un sujet si délicat, ce ne fut sans doute pas facile de narrer cette histoire 37 ans après, avec les mémoires divergentes et traumatisées. Le résultat, c’est un livre qui permet d’éclairer un peu cette période complexe, tissant un lien avec le présent du pays.
Lara Pawson vit à Londres et travaille comme journaliste freelance. Elle a déjà été correspondante pour la BBC à Luanda entre 1998 et 2000, ainsi qu’en Côte d’Ivoire, au Mali, et à São Tomé et Principe.
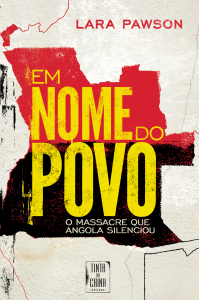 'In the name of the people', de l'édition Tinta da China
'In the name of the people', de l'édition Tinta da China
Il y a quelques années, vous avez dit que « faire des recherches et écrire ce livre a été la chose la plus difficile » de votre vie. A présent que le livre est sorti, et qu’il est lu, comment vous sentez-vous ?
Je me sens soulagée mais aussi un peu terrorisée. J’ai déjà eu des retours. Ils ont pourtant été très bons. Mais aussi tristes. Un ami proche m’a appelé pour me dire qu’il se posait des questions, ces 37 dernières années, sur ce qui était arrivé à son vieil ami. En lisant le premier chapitre de mon livre, il a compris que son ami était mort. Ce fut un moment très fort. Bien sûr, il y a aussi du positif. Ces vérités ont besoin d’être mises en lumière. C’est ce que je crois, c’est pour ça que j’ai écrit.
Avez-vous réussi à comprendre pourquoi vous vous intéressiez réellement à ce sujet ? En le comparant aux massacres britanniques, pourquoi étudier cette période sombre de l’histoire de l’Angola ?
C’est un point important, le Royaume-Uni a une histoire épouvantable dans une grande partie du monde. Nous avons trop de sang sur nos mains. Et nous continuons à avoir beaucoup sang qui nous tache les mains. La guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, et, sur notre propre territoire, nous tuons des gens, des innocents comme le père et époux angolais Jimmy Mubenga. Alors, oui, pourquoi une femme britannique comme moi choisit-elle d’explorer un événement de l’histoire de l’Angola relativement petit ? Enfin.
Tout le monde vous a posé cette question pendant vos recherches.
Il y a plusieurs motifs… L’Angola occupe une très grande place dans mon cœur. Peut-être parce que j’y ai vécu pendant la guerre : une période intense et compliquée mais qui m’a beaucoup appris sur l’amour, la vie, la guerre, et la mort. Je sens que je dois énormément à l’Angola et aux Angolais. J’ai commencé à m’intéresser au 27 mai pour trois raisons : tout d’abord, parce que la première fois que j’en ai entendu parler, à Luanda, je suis restée choquée de ne pas l’avoir su plus tôt. Cela m’a paru être un grand secret. Très sombre. Ensuite, un ami à moi, JoãoVan Dúnem, m’a raconté plus tard ce qui lui était arrivé, surtout à son frère José. Cette histoire m’a mise mal à l’aise et m’a vraiment dérangée. João m’a encouragée à écrire un livre, mais à une condition. Il m’a dit ainsi : « tu ne peux pas rédiger un de ces rapport de droits humains ! Écris un bon livre ! »
C’est João Van Dúnem qui vous a mis au défi, mais il n’a pas pu voir le livre terminé…
C’est terrible. Je me sens très mal à cause de cela. Je crois que João m’a presque laissé tombée, tellement j’ai été lente. Il se moquait déjà de moi. J’ai presque perdu la motivation, j’étais prête à abandonner. C’était très difficile pour moi d’écrire sur ce moment horrible, sanguinaire, en tant que femme blanche anglaise. Oui, j’ai été lente. Et les gens sont morts peu à peu. Ndunduma aussi n’est déjà plus parmi nous, et lui aussi s’est confié à moi. J’aurais aimé que tous les deux lisent et donnent leur avis sur ce livre.
Et la troisième raison ?
La troisième raison est simplement que je suis restée obsédée par le sujet, en particulier quand j’ai commencé à comprendre que quelques journalistes, historiens et intellectuels britanniques de gauche, des personnes que j’admire beaucoup – ont contribué à la quête de la vérité sur ce 27 mai.
Comme Michael Wolfers?
Exactement. Je dois malgré tout ajouter que… Wolfers a écrit quelque chose à propos du 27 mai. Pas comme les autres, il a au moins dédié deux chapitres au sujet dans son livre de 1983 Angola on the Frontline. C’est un livre qu’il a écrit avec une autre journaliste britannique, Jane Bergerol. Toutefois, ce qui m’a le plus déçue été le moment où il a adhéré à la version officielle du MPLA la considérant comme étant la seule correcte. Il a choisi un camp, et n’a pas cherché d’alternative à cette version officielle, ni même enquêté sur les morts qui ont suivi l’insurrection. Ça m’a déçue.
Un tabou ?
Lorsque vous avez décidé d’écouter les histoires des personnes, comment avez-vous été reçue ? Malgré la méfiance, voulaient-ils se livrer à vous ?
Ça a été difficile ! Mais cela dépendait des personnes. L’un des premiers entretiens que j’ai eu – avec une femme qui vit au Portugal et dont le mari a disparu le 27 mai à Luena, et qu’elle n’a plus jamais revu – a été en réalité un des plus faciles. Sa fille m’avait contactée par le biais d’une amie et m’avait demandé si je pouvais interviewer sa mère. J’étais nerveuse d’appeler sa mère, j’ai mis beaucoup de temps à rassembler mon courage. J’y ai pensé pendant deux semaines. Mais quand j’ai enfin passé le coup de téléphone, elle a été charmante. Elle a accepté. Nous nous sommes rencontrées, et bien que l’entrevue ait été incroyablement angoissante, la femme a été très ouverte, courageuse et honnête.
D’un autre côté, il y a eu des personnes plus compliquées. Même João Van Dúnem a été difficile à interpréter. Il me maintenait éloignée, tout en sachant, à l’époque, que je travaillais dans le même bâtiment ! Ensuite s’est posé le problème d’aller à la rencontre de ces personnes en Angola, de voyager en Angola. Cela a pris du temps pour obtenir le visa.
Encore une fois, j’ai presque abandonné.
 Lara Pawson
Lara Pawson
Et dans le cas des rencontres en Angola ?
Dans le pays, les personnes se sont montrées très ouvertes. Et moins elles avaient de pouvoir, plus elles étaient prêtes à parler. En fait, cela m’a impressionnée. Dans le même sens, plus elles avaient de pouvoir, moins elles avaient envie de parler. Ça c’est le mode de fonctionnement. Il se passe la même chose au Royaume-Uni.
Est ce que vous pensez que l’Angola va finalement être capable de parler du 27 mai 1977 en public ?
Je ne sais pas. C’est très difficile. Comme notre histoire avec l’IRA, au Royaume-Uni, et la guerre civile d’Espagne, et même l’Holocauste, c’est très difficile pour les personnes de parler de ces grands traumatismes. Je crois qu’il y a la honte des deux côtés : de la part des victimes, ou des survivants, et de la part de ceux que l’on juge être les auteurs. Je suppose qu’il est difficile de faire face à cet espèce d’échec. Il me semble que le 27 mai représente un moment de honte pour beaucoup de personnes. Je suis d’accord avec ce que l’historien David Birmingham a écrit, cela a été la fin de la lune de miel de l’indépendance pour le MPLA (bien que ce n’ait pas été une lune de miel amusante ou joyeuse), et cela doit être très difficile à accepter pour un grand nombre de personnes. Malgré tout, j’espère qu’au moins, mon livre aidera à initier plus de débats autour de ce sujet. Je pense que l’on commence déjà à en parler – on ne peut pas oublier le travail de personnes comme Miguel Francisco, « Michel », auteur de Nuvem Negra, et Dalila Cabrita Mateus, qui a écrit Purga em Angola, et d’autres aussi, notamment plusieurs journalistes angolais qui ont écrit des articles importants pendant des années et des années – mais j’espère que mon livre participe à un débat plus élargi, qu’il permet à des vérités d’éclater.
Populaire et élite dans la gestion de l’histoire
Avez-vous observé une plus grande transparence dans les discussions à Sambizanga ? M. Mateus a dit qu’ils voulaient être entendus par Neto, qu’ils allaient à une manifestation pacifique et avaient été accueillis par des bombes. Ces personnes ont été emprisonnées, Sambizanga démolie. Ils ont beaucoup souffert et un grand nombre d’entre eux n’ont jamais été entendus. Lorsqu’ils parlent avec vous, est-ce de manière plus altruiste ?
Eh bien, oui et non. J’ai été très émue lorsque M. Mateus a insisté pour que je le cite. J’ai trouvé ce courage assez révélateur, et j’ai compris que nous n’avions rien à perdre, pour peu que nous le voulions. Je crois que j’ai dit beaucoup en évoquant les personnes qui ont du pouvoir (et beaucoup à cacher), et les autres sans pouvoir (qui n’ont rien à cacher). Autre exemple, une journaliste anglaise et éditrice de la revue du Guardian, Victoria Brittain, s’était montrée réticente à parler avec moi. A côté d’elle, M. Mateus était comme un livre ouvert. Mais bien sûr, ce ne sont pas les contradictions qui manquent. En tant que personnalité, João Van Dúnem fait vraiment partie de l’élite, non ? Et pourtant, il m’a parlé longuement. Tout comme Ngdunduma, bien que ce dernier soit resté très évasif. João Melo, député du MPLA à l’Assemblée Nationale a, lui, été très ouvert. Il m’a surprise, j’ai cru qu’il jugerait mal le passé. Enfin, les gens contredisent toujours la règle. J’espère que ce que je dis ne sonne pas trop diplomatique.
Dans le livre, vous remettez tout en cause. Comme si vous vous méfiiez de ce qu’ils sont en train de vous raconter…
C’est vrai. Je remets beaucoup de choses en question, c’est aussi dû à la mémoire, après tant de temps elle est toujours incertaine.
Sur l’ensemble, les versions ne s’accordent pas toujours, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, est-ce un espace de doutes permanents ?
Il y a de nombreuses émotions et traumatismes impliqués. J’ai encore des doutes, je termine le livre dans un état de doute.
Est-il possible de se rapprocher d’une certaine vérité, dans un univers si révoltant et sensible ? Comment devons-nous nous y prendre ?
Vous avez raison, mais maintenant que le livre est fini, j’ai atteint une certaine vérité sur le 27 mai. C’est la suivante : je pense que, tout comme de nombreux événements politiques violents et complexes, cette vérité est contradictoire. Ainsi, de mon point de vue, il y a eu une tentative de coup d’état. Cependant, je suis certaine que, pour beaucoup de personnes impliquées, elles participaient simplement à une manifestation. Une manifestation pacifique, sans armes. Je crois qu’il est absurde d’essayer de faire apparaître au grand jour des vérités absolues, des versions définitives du 27 mai. Cela dépendra toujours de qui tu es, de ta place, et de ton positionnement dans l’événement.
Pour en revenir à Sambizanga, M. Mateus dit que Nito Alves n’a pas donné l’ordre de tuer, que la mort de ces dirigeants du MPLA capturés est survenue dans un moment de désespoir, quand le quartier était déjà encerclé. Qui en est à l’origine, finalement ?
Je ne suis pas tout à fait sûre. Qu’est-ce qu’un ordre donné ? Je ne sais pas. Auraient-ils été tués dans un instant de panique, en effet ? J’ai entendu ce que Mateus a dit. Sa mémoire est solide, mais je pense que des travaux bien plus importants doivent être menés à bien pour arriver à une conclusion définitive à ce sujet. Nous devons donner du poids à sa réponse, car elle contredit ceux qui insistent sur le fait que les « nitistas », partisans de Nito Alves, n’étaient pas coupables, comme ceux qui insistent sur le fait que Nito lui-même s’en est chargé ou avait autorisé l’assassinat.
La figure de Nito Alves a bénéficié en effet d’un soutien populaire solide, cela représentait-il une source de préoccupation pour les dirigeants de l’époque ?
Sans doute. D’ailleurs, la plus grande preuve de cela à mon avis se trouve dans le document lui-même du MPLA « la tentative de coup d’état du 27 mai 1977 » écrit par le Politburo [bureau politique] ! Il faut lire ce document. C’est fascinant, tant par sa propagande que par la vision qu’il donne de la pensée du Politburo à l’époque. J’ai une copie et je pourrais l’envoyer sans problème à ceux que cela intéresse. Ces documents doivent être vus et lus par tous.

L’enthousiasme d’Amnesty International pour Agostinho Neto et le soutien qu’il a reçu des Portugais sont à l’origine de ce mythe du Père de la Nation, une figure de culte, publiquement incontestable. Pourtant, quelques personnages de votre livre font référence à un côté sanguinaire. Comment l’expliquez-vous ?
Oui, il est vraiment difficile de critiquer Neto. Je trouve cela très frustrant. L’idée que le président lui-même n’avait en fait pas de pouvoir. Ça ne peut certainement pas être vrai. Je me demande si cela ne se serait pas passé avec n’importe quelle personnalité noire devenue le premier leader de l’indépendance d’Angola. Évidemment quiconque ainsi serait commémoré à grands renforts de gloire. C’est un exploit incroyable. Un peu comme Obama en tant que premier président noir des États-Unis : ce n’est pas facile pour les personnes de le critiquer, même si beaucoup d’entre nous sentent que ces politiques sont profondément infondées et que l’apparente volonté d’Obama d’employer les Forces Armées des États-Unis va dans le sillage de George Bush Jr. Nombreux sont ceux qui ont accusé Iko Carreira, Onambwe et Lúcio Lara, mais Neto a aussi joué un rôle important.
Race, classe et idéologie
Tout cela a lieu juste après l’indépendance, à la suite de nombreuses années de colonialisme qui ont formé une société hiérarchisée, faite de privilèges liés à la couleur : la question raciale a joué un rôle déterminant dans ces conflits, plus que les facteurs idéologiques ?
Au sein du MPLA ? Ou dans tout le pays ?
Dans les luttes internes du MPLA.
Bien sûr que les réverbérations du colonialisme portugais n’allaient pas disparaître subitement. Dans le livre, je cite un brillant académicien, Achille Mbembe. Dans son livre De la post-colonie, il pose cette question : « Existera-t-il une quelconque différence – et, si elle existe, quelle est-elle – entre ce qui se passa dans les colonies et ‘ce qui vint après ’ ? Est ce que tout aura réellement été remis en cause, suspendu, pour tout recommencer, véritablement, au point de pouvoir se dire que l’ancien colonisé retrouve l’existence, s’il s’éloigne de son état antérieur ? »
Ces mots et cette question de Mbembe m’ont accompagnée tout au long de ma recherche. Je dirais que la hiérarchie raciale établie sous domination européenne s’est maintenue à l’indépendance de l’Angola, jusqu’à aujourd’hui. La question de la race et des hiérarchies sociales en Angola sont un tabou immense, me semble-t-il. Les personnes – là encore, les puissantes – n’aiment pas en parler. Mais, selon ma petite expérience, ceux qui n’ont pas de pouvoir en parlent volontiers.
Cependant, je ne dirais pas que la race ait été le seul facteur. Les hiérarchies de classe et économiques étaient également en jeu. Tout comme les vieilles alliances entre familles, entre générations, entre ceux qui étaient en exil pendant la lutte pour la libération et ceux, comme Nito Alves, qui risquèrent leurs vies en combattant dans la brousse.
On ne fait pas disparaître une société raciste comme ça, d’un moment à l’autre.
Il est évident que l’idéologie et les idées idéologiques doivent être prises en compte, mais je considère que la race, la classe, l’histoire de l’engagement d’un peuple dans la guerre de libération – autant à Lisbonne qu’à Brazzaville, Dar es Salaam ou luttant pour survivre aux Dembos, ou où qu’ils soient en train d’opérer en cellules alternatives dans des zones urbaines – ont construit toutes ces tensions, ces ressentiments et ces expériences.
Il faut dire aussi que dans n’importe quelle guerre il est inévitable qu’il y ait des personnes qui meurent. Je pense que cette tension entre la nécessité de discipline et d’unité et les objectifs de libération – soit égalité, justice, liberté – va toujours s’effondrer. Et bien sûr, c’est comme ça qu’arrivent au pouvoir les personnes qui deviennent corrompues avec le temps.
Ces jeunes – léninistes, maoïstes, les Comités de quartiers – ont-ils pris l’idéologie au sérieux ? Ont-ils réussi à agir selon ce type d’organisation et à accéder à des lectures marxistes ou était-ce « l’air du temps », une mode de la décennie ?
Je pense que c’était probablement un peu des deux. Je crois que les idées marxistes ont fait effet, mais c’était aussi l’époque dans laquelle cela était en train de se passer. J’aimerais saluer le magnifique travail de Mabeko-Tali pour répondre à cette partie de la question : il a tellement bien écrit sur ces divers comités, groupes, et tous les fragments et composantes qui forment le MPLA.
Il y a eu sans aucun doute une immense organisation. Il me semble que les personnes adhèrent réellement à ces idées, aussi confuses et emmêlées soient-elles.
João Faria fait un peu la satire de tout cela.
Ce cher João Faria, probablement le plus ingénu de toutes les personnes avec qui j’ai parlé. Il se moque de lui même en tant que leader du groupe José Estaline et de son alliance avec les maoïstes et stalinistes. Penser à cela maintenant me donne envie de rire.
Pour parler de la répression qui a suivi le 27 mai 1977, n’y a-t-il pas un moyen d’être sûr du nombre de victimes ?
Je ne crois pas. Il me faut être prudente dans ma réponse à cette question. Comme je l’affirme en toute franchise dans le livre, je n’ai pas de preuves concrètes du nombre de personnes assassinées, 50 000 ou 80 000 ou 25 000. Ndunduma m’a cité Iko Carreira, l’ancien ministre de la Défense, pour qui, en accord avec Ndunduma, l’estimation tournait autour de 2 000 morts. Maintenant, si nous – pour le bien de la raison – acceptions que ce soit « seulement » 2 000 morts et non 20 000, cela fait quand même un grand nombre de décès. Même s’il n’y a pas eu de coup d’état, indépendamment du fait que l’on accepte ou non un coup d’état, il me semble que 2 000 morts c’est beaucoup. Et si Iko mentait ? Ou, si Iko Carreira ne connaît tout simplement pas les vrais chiffres ? Et si en fait ils sont bien au nombre de 5 000 morts ? C’est un chiffre énorme. Ce qui me préoccupe, avec les estimations qui montent et qui descendent, c’est que, ironiquement, nous nous risquons à dévaloriser la propre mort. Je veux faire une autre citation, à laquelle je fais également référence dans le livre, de la philosophe Judith Butler. Elle remarque que savoir compter « n’est pas la même chose que comprendre de quelle manière une vie compte et que, de fait, elle compte ». Alors, ne me comprenez pas mal : je pense que l’Angola, en tant que société, nation, a besoin d’une recherche juridique sur le nombre de morts pour découvrir qui est mort et où, mais je pense aussi qu’il est important pour les gens de se rappeler que 5 000 personnes, cela fait beaucoup de morts. J’espère que cela a du sens, c’est très délicat. Ce que j’essaye de dire c’est que chaque mort compte, qu’elles aient été 2 000, 5 000 ou 30 000.
Après les tortures, les morts massives, les parents et enfants disparus, les pertes d’amis… les Angolais donnent l’impression d’avoir, malgré tout, une grande capacité de régénération, de pouvoir ainsi rencontrer des ennemis et même de travailler avec eux. Comment expliquez-vous cette capacité à « pardonner » ?
Je ne suis pas sûre de pouvoir l’expliquer. Je crois que c’est une capacité humaine, qui n’est pas propre aux Angolais. Les gens ont des pouvoirs extraordinaires de pardon, une grande générosité est présente dans leurs cœurs. Je sens que, très certainement, c’est en Angola que j’ai appris comment on peut aimer de notre mieux. Je veux dire, avec tout son cœur. J’ai beaucoup appris de la générosité que j’ai senti chez les personnes en Angola – qu’elles soient dans un immense bien-être ou pas–. Je pense qu’il y a beaucoup d’amour en Angola, et une grande volonté de paix. C’est peut-être le résultat de l’expérience d’une grande souffrance.
Hier et aujourd’hui
Quand vous parlez du réaménagement de l’actuelle Baixa de Luanda, vous avancez l’idée de la tentative d’effacement de la mémoire. A Sambizanga, ils disent qu’ils boivent pour oublier… est-ce un oubli nécessaire ?
Qui sait, qui sait ? Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que c’est quelque chose de tellement personnel. Quelques-uns ont besoin d’oublier pour avancer, d’autres, de se confronter à l’histoire et à leur passé avant de réussir à aller de l’avant.
Lorsque nous lisons votre livre, nous avons accès à deux périodes, celle de la mémoire et celle correspondant à la situation de la personne et du pays tel qu’il est actuellement. Comment avez-vous construit la structure du livre, avez-vous tout de suite pensé à ce mélange de plans ?
J’ai passé beaucoup de temps à me préoccuper de la structure du livre. Je n’arrivais pas à savoir comment le construire. C’est lié à ma manière de penser – j’ai un gros problème avec les structures ! Mais il me fallait juste m’asseoir et raconter l’histoire telle qu’elle s’était déroulée. Et c’est comme ça que j’ai commencé à le faire, je me suis rendu compte que cela fonctionnait, particulièrement chez les lecteurs de langue anglaise qui ne connaissent rien de l’Angola. Cette structure, qui suit ma recherche, m’a permis de gagner je ne sais combien de lecteurs, entendus le long du chemin.
Interview initialement produite et publiée pour REDE ANGOLA